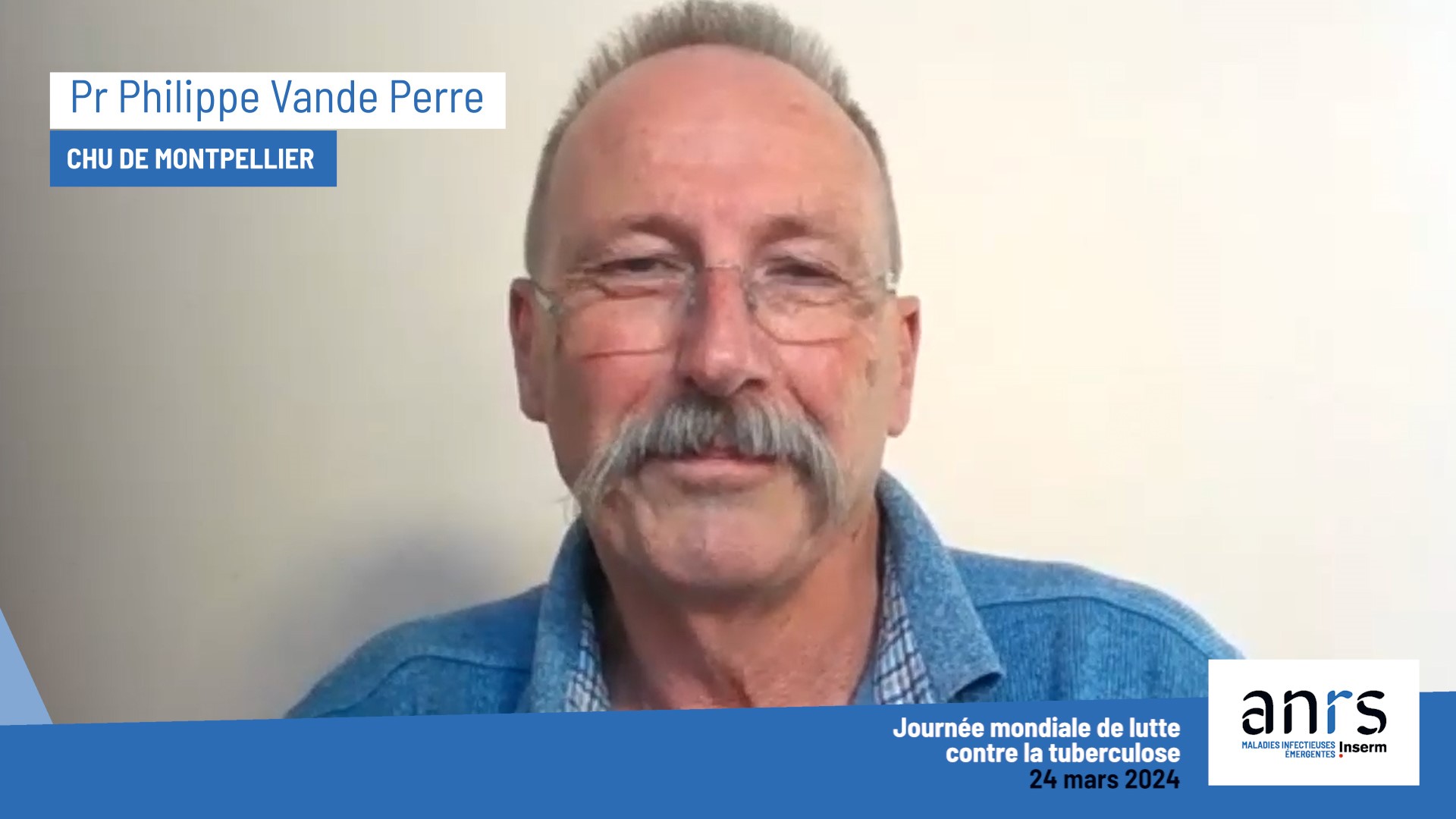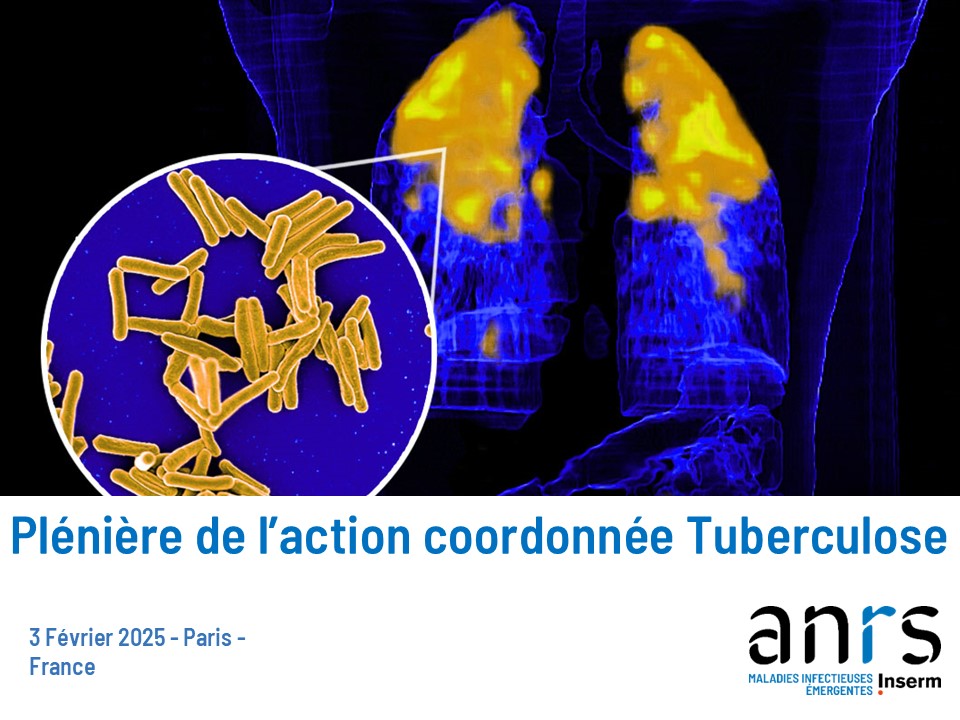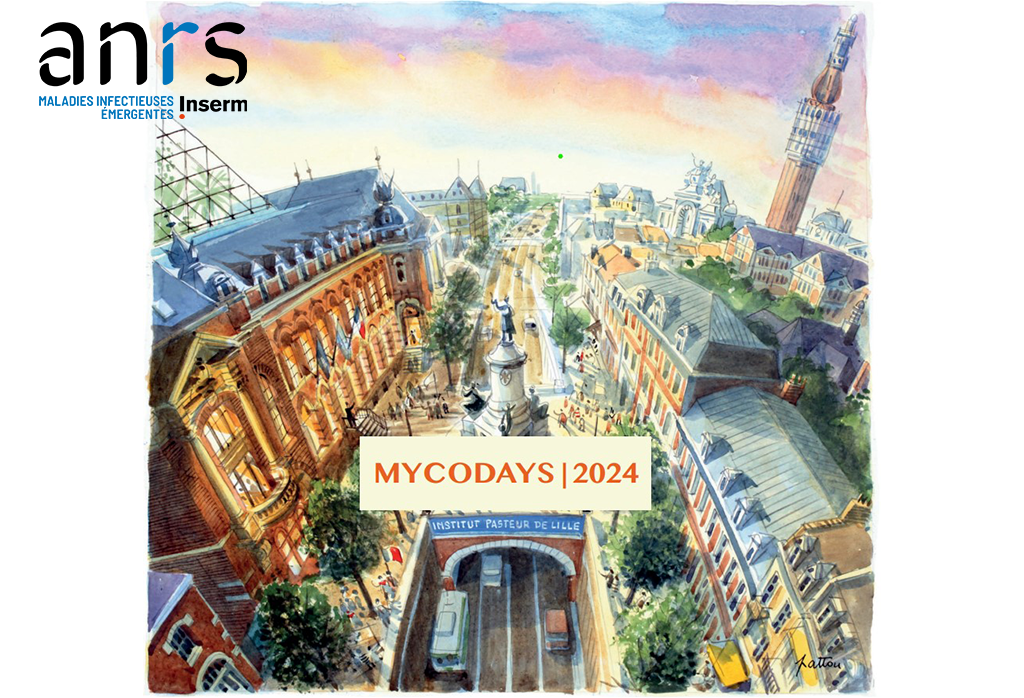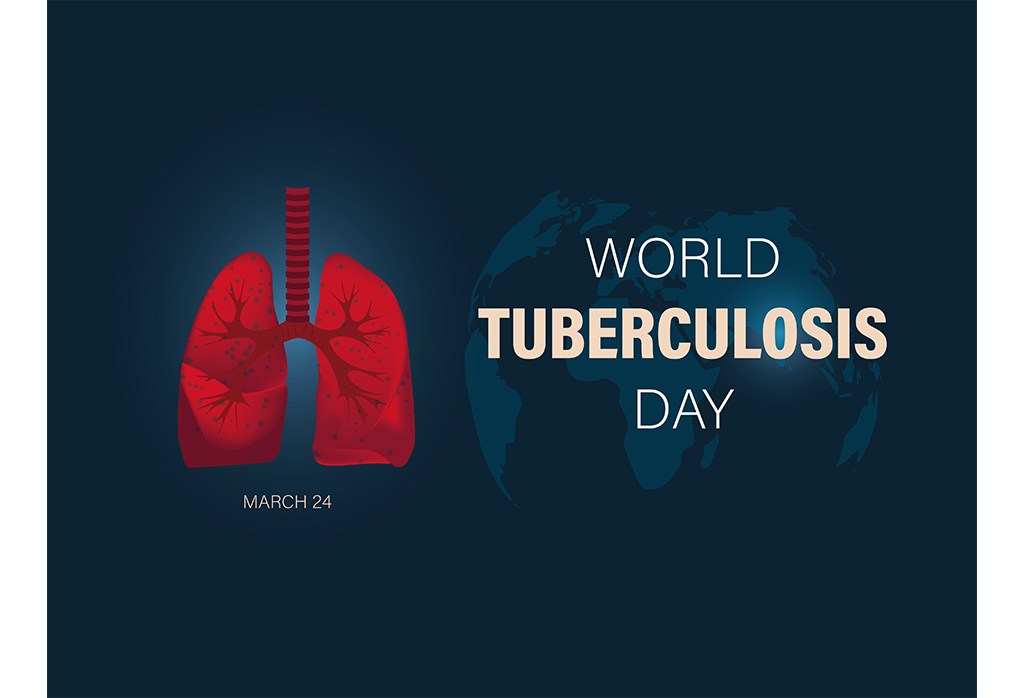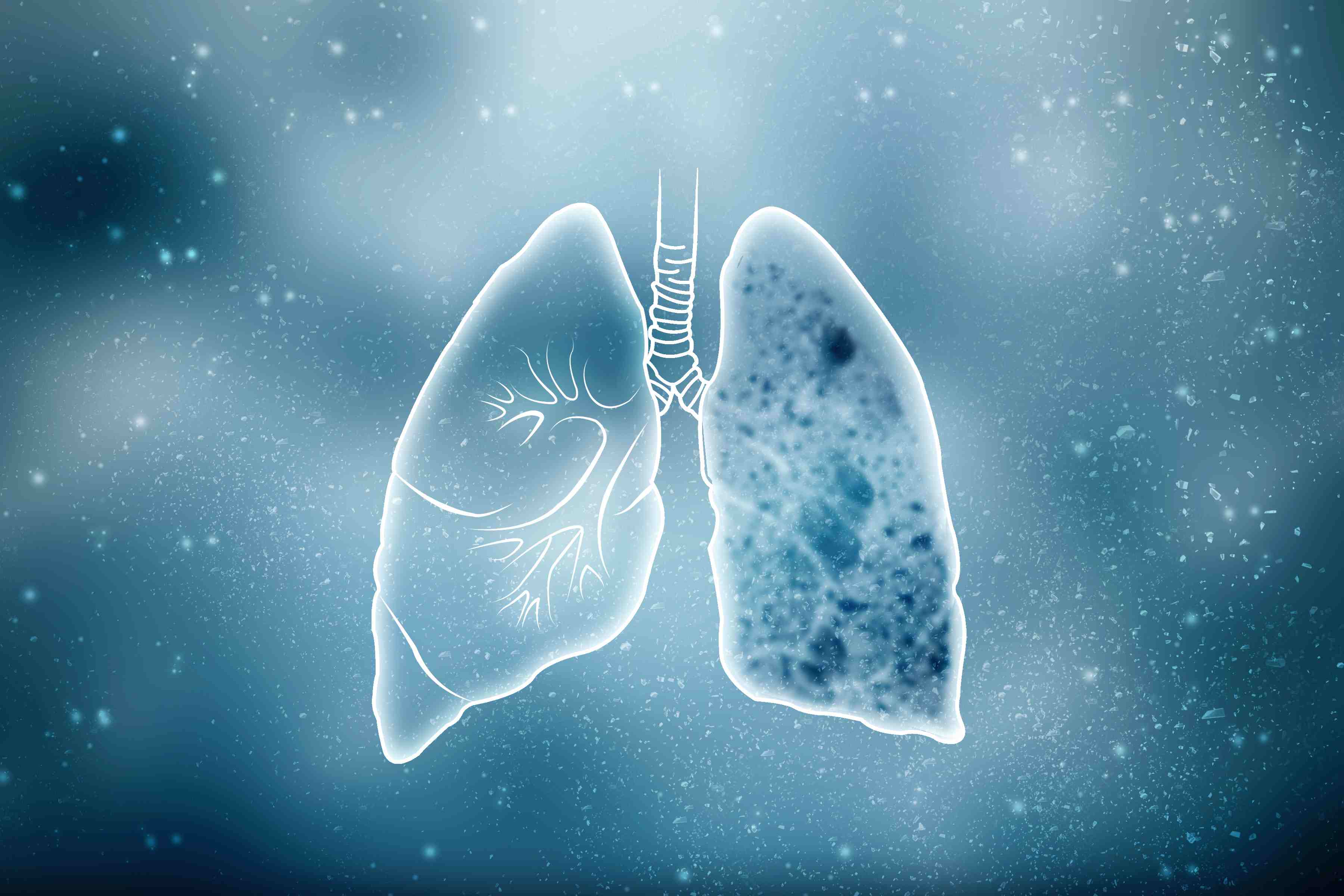
Action coordonnée Tuberculose (AC TB)
Dernière mise à jour le 24 avril 2025
L’essentiel
L’action coordonnée (AC) Tuberculose (TB) vise à faciliter le montage de projets collaboratifs, renforcer la R&D et proposer de nouvelles approches diagnostiques, thérapeutiques et vaccinales en réponse aux grandes problématiques sur la tuberculose.
Avec 10,6 millions de cas recensés et à peu près 1,3 million de décès en 2022 dans le monde (OMS, novembre 2023), ce qui en fait la deuxième cause majeure de mortalité due à un seul agent infectieux, la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique. L’AC TB vise à réduire cette mortalité.
Activités de l’action coordonnée tuberculose
Les objectifs de l’AC TB :
- La facilitation du diagnostic des différentes formes de la maladie dans certaines populations sensibles (enfants, immunodéprimés, femmes enceintes)
- La lutte contre la résistance aux antituberculeux avec l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant Mycobacterium tuberculosis ou l’hôte
- Le développement de stratégies innovantes de prévention (candidats vaccins, corrélats de protection, mécanismes de protection immunitaire…)
Les missions de l’AC TB :
- Assurer une animation scientifique transverse afin de stimuler une recherche de haut niveau sur la tuberculose ;
- Identifier les priorités de recherche et fédérer la communauté autour de thématiques phares ;
- Renforcer les collaborations et réseaux, en particulier entre recherche fondamentale, préclinique et clinique, et à l’international ;
- Augmenter la visibilité internationale de la recherche sur la tuberculose soutenue par l’ANRS MIE ;
- Attirer et soutenir la nouvelle génération de chercheurs. En particulier, renforcer le rôle des jeunes chercheurs dans l’organisation et l’animation des événements et contribuer à la valorisation de leurs travaux.
Mots clés : Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, physiopathologie, interaction hôte-pathogène, prévention, vaccin, diagnostic, traitement, mortalité, santé publique, recherche fondamentale, recherche clinique, tuberculose extra-pulmonaire, tuberculose latente, résistance au traitements, thérapies ciblant l’hôte, co-infection TB-VIH, immunodépression, femme enceinte, enfant, adolescent, persistance, corrélats de protection.
Présidence et co-présidence

Olivier Neyrolles
IPBS, CNRS, Toulouse

François-Xavier Blanc
Nantes Université, CHU Nantes
Bureau
Alain Baulard
(Centre d’Infection et d’Immunité de Lille, Institut Pasteur de Lille)
Guislaine Carcelain
(Hôpital Robert Debré, Paris)
Didier Laureillard
(CHU, Nîmes)
Olivier Marcy
(IRD EMR271, Université de Bordeaux)
Maryline Bonnet
(IRD, Montpellier)
Philippe Vande Perre
(UMR Pathogenesis and control of chronic and emerging infections, Montpellier )
Nathalie De Castro
(AP-HP, Hôpital Saint-Louis, Paris)
Guia Carrara
(Département recherche fondamentale, ANRS MIE )
Maimouna Djamila Ngadjaga
(Département recherche fondamentale, ANRS MIE )
Groupes de travail
L’AC TB s’articule autour de trois groupes de travail (GT) transverses qui couvrent la physiopathologie de la maladie (biologie du pathogène, réponse immunitaire de l’hôte, interactions hôte-pathogène), la prévention, le diagnostic, le traitement et la santé publique :
- GT1 : Tuberculose chez la mère et l’enfant (Olivier Marcy et Philippe Vande Perre)
- GT2 : Tuberculose et immunodépression (François-Xavier Blanc et Nathalie De Castro)
- GT3 : Nouvelles stratégies thérapeutiques et vaccinales (Alain Baulard et Maryline Bonnet)
Lutte contre la tuberculose : les objectifs et réalisations de l’action coordonnée
Entretien avec les co-présidents de l’action coordonnée, Olivier Neyrolles et François-Xavier Blanc.
1.Pouvez-vous nous rappeler les raisons qui ont motivé la création de l’action coordonnée de l’ANRS MIE sur la tuberculose ?
Olivier Neyrolles. La création de l’action coordonnée (AC) sur la tuberculose par l’ANRS MIE a été motivée par la nécessité de répondre à l’urgence sanitaire mondiale posée par la tuberculose, qui reste la maladie infectieuse la plus meurtrière, avec une estimation de plus de 10 millions de nouveaux cas et de plus de 1,2 million de décès en 2023. La situation s’est aggravée avec la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les services de santé, inversant ainsi les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies. De plus, la montée des cas de tuberculose multirésistante (RR/MDR-TB) représente une menace majeure pour la santé publique mondiale. Selon le dernier rapport de l’OMS, environ 400 000 personnes ont développé une tuberculose résistante en 2023. Parmi elles, seules 44 % ont été diagnostiquées et traitées, malgré un taux de succès thérapeutique de près de 70 % pour ces cas, ce qui reflète une amélioration par rapport aux années précédentes. La faible efficacité du vaccin BCG contre les formes pulmonaires de la maladie et les difficultés persistantes en matière de diagnostic et de traitement ont également souligné la nécessité d’une stratégie coordonnée pour stimuler la recherche et l’innovation dans ce domaine.
La France est considérée comme un pays à faible incidence de tuberculose, avec une diminution moyenne de près de 5 % par an depuis plusieurs décennies. Cependant, cette tendance a été interrompue par des variations ponctuelles, notamment en lien avec des événements extérieurs. Certaines régions présentent des taux d’incidence plus élevés. La Guyane, Mayotte et l’Île-de-France sont particulièrement touchées. Par exemple, en 2022, la Guyane affichait un taux de 18,9 cas pour 100 000 habitants, et Mayotte 13,2 cas pour 100 000 habitants. L’Île-de-France concentre environ un tiers des cas nationaux, avec une incidence notable en Seine-Saint-Denis. La tuberculose affecte principalement les populations en situation de précarité, les migrants et les personnes âgées. Les personnes sans domicile fixe présentent une incidence particulièrement élevée, estimée à 170 cas pour 100 000 habitants. Les personnes nées hors de France sont également plus touchées, avec un taux de 34 cas pour 100 000 habitants.
La création de l’AC a permis de fédérer une communauté de chercheurs, médecins et acteurs de la santé pour réfléchir et monter ensemble des projets concernant cette problématique majeure de santé publique.
François-Xavier Blanc. Historiquement, l’ANRS MIE a déjà financé plusieurs projets importants concernant le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. L’agence a ainsi contribué à faire modifier plusieurs recommandations de l’OMS dans ce domaine. Son terrain d’action comportait quasiment exclusivement les pays à forte prévalence de tuberculose, notamment en Afrique sub-Saharienne, en Asie du Sud-Est et dans quelques pays d’Amérique du Sud. La création d’une AC permet évidemment d’élargir ce périmètre de manière significative : toute la recherche sur la tuberculose est désormais potentiellement éligible à un financement, bien au-delà de la co-infection avec le VIH, et tous les territoires sont concernés, y compris la France où une cohorte nationale de patients devrait rapidement voir le jour.
2.Quelles étaient les priorités initiales du groupe lors de sa création ?
Olivier Neyrolles. Les priorités définies lors de la création de l’AC incluaient :
- L’amélioration des outils de diagnostic, en particulier pour les formes latentes, extra-pulmonaires et les populations vulnérables comme les enfants et les personnes immunodéprimées.
- Le développement de nouveaux traitements plus courts et mieux tolérés, en ciblant les bactéries persistantes et les mycobactéries multirésistantes.
- La recherche de nouveaux vaccins plus efficaces que le BCG, nécessitant une meilleure compréhension des mécanismes de protection immunitaire.
- Le renforcement des collaborations entre recherche fondamentale, préclinique et clinique, ainsi qu’entre les chercheurs du Nord et du Sud, afin de créer des synergies et des approches multidisciplinaires.
- L’augmentation de la visibilité internationale de la recherche française sur la tuberculose et l’attraction de nouvelles générations de chercheurs.
3.Quelles sont les principales réalisations du groupe depuis sa mise en place ?
François-Xavier Blanc. L’AC Tuberculose s’est organisée en trois groupes de travail (GT) : « Tuberculose dans la relation mère-enfant », « Tuberculose et immunodépression », et « Nouveaux traitements et vaccins ». Depuis sa création, l’AC a organisé plusieurs événements scientifiques majeurs pour dynamiser la recherche. Un workshop inaugural a été tenu fin 2022, réunissant les principaux acteurs de la recherche sur la tuberculose en France pour favoriser les échanges entre les disciplines (fondamentale, préclinique, clinique) et présenter les ressources disponibles comme les cohortes et biobanques. En 2023, un symposium de consolidation a permis de poursuivre ces discussions et d’affiner les orientations stratégiques du groupe. En janvier 2024 et février 2025 se sont tenues deux assemblées plénières de l’AC. Lors de ces rencontres, les travaux de recherche financés par l’ANRS MIE sont présentés par leurs auteurs. Des ateliers sont organisés autour de thématiques particulièrement sensibles, « Infection latente et tuberculose subclinique : Dépistage, traitement et suivi » et « Tuberculose maladie : Traitements, marqueurs de réponses aux traitements et adaptation des traitements aux populations » pour ce qui concerne l’édition 2025 par exemple. Des rencontres annuelles ou bisannuelles de type « Work in Progress » de chaque groupe de travail sont également organisées. Ainsi, en juillet 2024 s’est tenu à Lille un symposium organisé par le GT « Nouveaux traitements et vaccins » et la Société Française de Microbiologie où se sont rencontrés chercheurs et cliniciens pour échanger sur la recherche fondamentale et pré-translationnelle, de nouvelles thérapies en particulier, l’épidémiologie, la résistance aux traitements, les innovations en diagnostic et les interactions hôte-pathogène dans la tuberculose. Des symposiums internationaux sont envisagés pour maintenir cette dynamique et accroître la visibilité de la recherche française.
4.Le groupe a-t-il collaboré avec des partenaires internationaux ou locaux ? Si oui, quelles ont été les retombées de ces collaborations ?
Olivier Neyrolles. L’AC TB a activement renforcé des collaborations à la fois locales et internationales. Sur le plan local, le réseau a consolidé les liens entre les laboratoires fondamentaux (via des structures comme le Mycoclub) et les centres cliniques, facilitant ainsi le transfert des connaissances et des technologies. Au niveau international, des partenariats avec des pays fortement touchés par la tuberculose (Inde, Afrique du Sud, etc.) ont été établis pour partager des données, des ressources (cohortes, biobanques) et des stratégies de lutte contre la maladie. Ces collaborations ont permis des avancées dans le diagnostic, le traitement et la compréhension des dynamiques épidémiologiques de la tuberculose.
5.Selon vous, quelles avancées scientifiques ont été les plus marquantes dans la lutte contre la tuberculose soutenues ou facilités par cette action coordonnée ?
François-Xavier Blanc. Parmi les avancées les plus significatives, on peut citer :
- Le repositionnement de molécules existantes pour des traitements personnalisés en fonction des profils de patients (enfants, immunodéprimés, etc.).
- Le développement de stratégies innovantes pour cibler les bactéries persistantes, soit en tentant de les éliminer directement, soit en les réactivant pour les rendre sensibles aux traitements classiques.
- L’exploration des thérapies dirigées contre l’hôte (« host-directed therapies ») pour améliorer la réponse immunitaire contre les mycobactéries, ou « anti-virulence » pour cibler des mécanismes du pathogènes requis pour son cycle infectieux.
- Des progrès dans la compréhension des mécanismes immunitaires et des corrélats de protection, essentiels pour le développement de vaccins plus efficaces que le BCG.
6.Quels sont les projets prioritaires pour les prochaines années ?
Olivier Neyrolles. Les projets prioritaires incluent :
- La poursuite des essais cliniques pour développer des traitements plus courts et moins toxiques, en ciblant les bactéries persistantes et en adaptant les traitements aux différents profils de patients.
- Le développement de diagnostics plus rapides et plus simples, en particulier pour les pays du Sud, avec des tests basés sur des biomarqueurs détectables dans les fluides corporels.
- L’avancement des recherches sur des vaccins innovants, en explorant des approches comme la vaccination muqueuse.
- L’étude des comorbidités, telles que le diabète, qui influencent la progression et la prise en charge de la tuberculose.
François-Xavier Blanc. Les projets prioritaires sont sélectionnés lors des appels à projet par un Conseil scientifique distinct de l’AC. L’AC n’est donc pas du tout décisionnaire en la matière. Elle tente de faire émerger des thématiques parfois négligées mais son rôle d’animation de la recherche scientifique s’arrête là. Elle ne peut évidemment pas se substituer aux évaluateurs scientifiques indépendants en charge des projets déposés à l’ANRS MIE lors de chaque appel à projets.
7.Prévoyez-vous de renforcer les partenariats existants ou d’en développer de nouveaux ?
Olivier Neyrolles. Oui, l’AC TB prévoit de consolider ses collaborations actuelles, notamment en renforçant les synergies entre les chercheurs du Nord et du Sud. Ainsi, par exemple, un appel à projets a été lancé en 2024 conjointement par l’ANRS MIE et le South African Medical Research Council (SAMRC) pour financer des projets conjoints entre équipes françaises et sud-africaines. De nouveaux partenariats seront également recherchés avec des institutions internationales et des réseaux de recherche en épidémiologie et en santé publique afin d’accroître l’impact global des initiatives de recherche sur la tuberculose.
8.Quelles innovations ou pistes de recherche pourraient, selon vous, transformer la lutte contre la tuberculose dans un futur proche ?
Olivier Neyrolles. Les innovations prometteuses incluent :
- Le développement de vaccins rationalisés avec de nouvelles méthodes d’administration, comme la vaccination muqueuse, qui pourrait améliorer la protection contre les formes pulmonaires.
- Les thérapies dirigées contre l’hôte pour surmonter la persistance des mycobactéries et réduire la durée des traitements.
- L’utilisation de biomarqueurs pour des diagnostics précoces et plus précis, adaptés aux besoins des pays à ressources limitées.
François-Xavier Blanc. Il est essentiel de rappeler ici que la tuberculose est toujours directement responsable d’une mortalité importante dans le monde, ce qui reste à nos yeux vraiment inacceptable. Le développement et la mise à disposition à des coûts réduits d’outils diagnostiques et/ou pronostiques plus performants permettrait de transformer la lutte contre la tuberculose, tout comme l’a fait il y a plus de 10 ans la PCR automatisée permettant de savoir en 2 heures, à peu près partout dans le monde, si un(e) patient(e) était atteint(e) de tuberculose et s’il existait ou pas une suspicion de résistance à la rifampicine et donc de multi-résistance. Dans un futur proche, une autre avancée majeure serait de parvenir à une réduction très significative de la durée de traitement de la tuberculose, actuellement toujours à plusieurs mois et grevée de certaines difficultés. Mails il reste encore beaucoup de travail avant de parvenir à de tels résultats. D’où la nécessité de regrouper les forces vives !
9. Comment des chercheurs peuvent-ils contribuer ou participer à l’action coordonnée ?
Olivier Neyrolles. Les chercheurs peuvent s’impliquer en rejoignant les groupes de travail thématiques de l’AC TB, en participant aux événements scientifiques organisés (workshops, symposiums) et en contribuant à la valorisation des ressources existantes (cohortes, biobanques). L’AC encourage également la participation de la jeune génération de chercheurs et chercheuses, notamment à travers la création d’un Prix de thèse annuel pour récompenser les contributions innovantes dans le domaine de la recherche sur la tuberculose.
François-Xavier Blanc. Tout le monde est bienvenu. Chacun pourra trouver sa place. Le partage d’informations et le développement de collaborations sont activement encouragés. Il faut donc venir avec ses compétences et une grande ouverture d’esprit. Le plus simple est de s’intégrer à l’un des 3 groupes de travail et de proposer une thématique de recherche susceptible d’intéresser d’autres chercheurs. Après, il faudra passer à l’action et construire des projets collaboratifs qui seront soumis pour financement dans un contexte de concurrence avec les autres thématiques relevant de l’ANRS MIE. Au final, la multidisciplinarité restera une source de forces et de progrès, c’est certain.
Groupe de travail 1 : la tuberculose chez la mère et l’enfant
- La tuberculose demeure la principale cause de décès maternel non obstétrical dans le monde, représentant entre 15 et 34 % des cas.
- Ce groupe de travail se concentre sur un sujet souvent négligé : la tuberculose chez les femmes enceintes, en post-partum et les jeunes enfants.
- Composé de 37 experts internationaux, principalement des chercheurs, cliniciens, infectiologues, gynécologues-obstétriciens et pneumologues, ce groupe vise à susciter une réflexion approfondie sur cette problématique et à encourager de nouveaux projets collaboratifs dans ce domaine.
Découvrez dans l’interviewe du Pr Philippe Vande Perre, l’un des deux coordinateurs du groupe de travail sur la tuberculose chez la mère et l’enfant avec le Pr Olivier Marcy, les travaux menés par l’action coordonnée tuberculose pour faire avancer la recherche dans la lutte contre cette maladie.